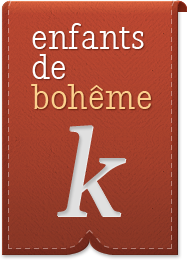
Par Sophie Képès le 29 Juin 2011
Hier, en fin d’après-midi, je présentais mon dixième livre aux diffuseurs. Il faisait froid, très froid dans le hall de l’hôtel. Et malédiction ! le bar était fermé. Faisant antichambre avec quelques auteurs, dirdecols et responsables commerciaux, je me retrouvai entourée par trois personnalités : Pénal, pape du polar, Surin, éminence grise, et un type sympathique, qui s’avéra avoir dirigé la section espagnole d’un grand périodique.
Sachant me tenir à ma place, j’écoutais sans y prendre part les propos qu’échangeaient ces gens bien informés. On s’attaqua d’abord au supplément littéraire du quotidien de référence, qui en prit pour son grade. On le compara à son homologue new-yorkais, à l’avantage duquel ? devinez. On s’étonna que des gens continuent à lire ce torchon, fort peu nombreux à la vérité. Mais que voulez-vous, les auteurs, eux, appréciaient toujours d’y obtenir un article.
J’étais d’accord avec tout cela, et fis ce commentaire mezzo-voce : « Hé oui ! ce qui est bizarre avec le prestige, c’est qu’il perdure au-delà de toute raison. Un peu comme la lumière fossile d’un astre mort. » Les trois barons des lettres me jetèrent un coup d’oeil pour la première fois. « Bien dit ! fit l’un. – Beau sens de la formule ! approuva l’autre. – Vous devriez écrire », ajouta le troisième. J’opinai modestement : « Je vais y penser », dis-je.
La conversation dévia sur les stars féminines du cinéma d’antan. Surin détestait Marlene Dietrich, Pénal l’adorait. Greta Garbo fut jugée unanimement masculine. « Et Ava Gardner ? » intervins-je. A nouveau, je tombai juste : Gardner était sublime, désirable pour l’éternité. Nous commencions à nous aimer tendrement.
Soudain l’Espagnol mentionna ses tatouages. Il en avait sur tout le corps. Pourtant, il n’était pas grand… « Un pour chaque livre », fit-il, mystérieux, en ouvrant le bouton de son col afin de nous montrer un échantillon. Cette idée m’excita : « Quel merveilleux sujet de roman : un tatouage, un chapitre, imaginez ! » J’étais ravie. Lui me tutoyait déjà, à l’espagnole. Nous nous aimions de plus en plus. Mais il fut appelé dans la salle où l’on officiait. Il fournit sa prestation de trois minutes et ressortit. « Alors, vous leur avez montré tous vos livres ? » demandai-je, enjôleuse. Il secoua la tête. Nous échangeâmes encore quelques mots. J’appris qu’il était le père d’un chanteur connu de tous, sauf de moi.
Entre-temps, Pénal et Surin s’étaient fait la malle. Je continuai à poireauter, seule.
Le camion des lettres françaises redémarra.