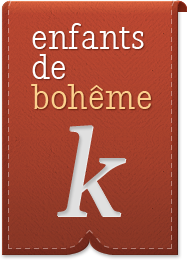
Par Sophie Képès le 24 May 2024
Le prix Cesare Musatti m’honore et m’émeut pour une raison que ceux qui me l’ont décerné ne peuvent pas connaître. La voici : j’ai commencé mon analyse avec Cesare Musatti. Je faisais la navette entre Padoue et Milan, ces trajets étaient fatigants. Un jour, Musatti s’est procuré la liste des membres de la Société Psychanalytique Italienne, a marqué un nom et m’a conseillé d’aller voir celui-là. Il habitait dans la même ville que moi. J’ai fait de lui le protagoniste du roman « La maladie humaine » (1).
À part quelques écrivains qui étaient ou sont mes amis (Pasolini, Ottieri, Volponi, Bertolucci, Zanzotto…), les autres restent à l’écart de la psychanalyse. Ils ont l’impression que faire une analyse, c’est mourir et renaître, mais renaître privé de la poésie et de l’écriture. Musatti m’a expliqué ainsi cette résistance : « Avant la première séance, j’aime demander à ceux qui viennent me voir : si j’avais un bouton sur la table, et qu’en pressant ce bouton, vous pouviez vous lever libéré de la souffrance et de ses causes, les souvenirs, les secrets, les tabous ; s’il suffisait d’appuyer sur ce bouton pour vous lever différent et méconnaissable, est-ce que vous le feriez ? » Musatti m’a dit que tout le monde, avec honnêteté, avait répondu non. Appuyer sur le bouton est aussi dangereux que mourir. Celui qui est névrosé ne veut pas perdre sa névrose. S’il voulait la perdre, il ne l’aurait pas. Il ne fait pas d’analyse parce qu’il veut guérir, mais parce qu’il n’arrive pas à le vouloir.
Je dois à Musatti une autre explication préliminaire : l’analyse est à l’individu ce que la guerre civile est à l’État. Si l’État veut combattre la guérilla, il ne peut pas dire : je l’affronterai à Milan et à Rome, mais pas à Venise et à Trieste, car alors les guérilleros se réfugieront tous à Venise et à Trieste, et ces villes que l’État voulait préserver intactes, il devra les raser totalement. De même, on ne peut pas dire : je parlerai de tout sauf de ma mère et de mes écrits, parce que cela deviendra les seuls sujets à traiter, tous les symptômes dont on souffre se transféreront et se reproduiront dans ces îlots protégés, et il faudra les bombarder et les brûler. Pasolini a tenu quelques séances, puis il s’est heurté au problème de l’homosexualité : Musatti l’incitait à affronter l’homosexualité en tant que culture (2), Pasolini voulait la laisser de côté en tant que nature, et finalement, plutôt que de déclencher une crise, il s’est retiré. Son analyse a pris fin et avec elle, j’en suis convaincu, sa vie aussi a commencé à prendre fin. (Pasolini a été mon père trois fois : préfacier de mon premier roman, de mon premier recueil de poèmes, et chroniqueur de mon premier ouvrage de critique.)
J’ai appris d’emblée, chez Musatti, que la séance était irracontable. Musatti l’explique ainsi : « Souvent, au milieu d’une séance, je souris et je pense : si un policier entrait ici et entendait ce que nous nous disons, il nous emmènerait tous les deux en prison pour association de malfaiteurs. » « Policier » signifie « État ». Je pense que « analyse » et « État » sont antinomiques. L’analyse est subversive, la guérison advient par le biais de la subversion.
J’ai tenté de restituer ce caractère indicible dans un roman, « La maladie humaine », qui n’est pas un journal d’analyse mais se situe en amont et en aval de l’analyse. C’était l’analyse d’un homme. Or ce sont les femmes qui étaient le plus intriguées. Je pense avoir eu alors, en six mois, une vingtaine d’entretiens, tous avec des femmes journalistes. Italiennes, françaises. Elles venaient avec un cahier et un stylo pour prolonger leur lecture au-delà de la fin du livre, assister à une séance supplémentaire avec un homme et jouer le rôle d’analystes. Elles ont payé ce privilège en me confessant leurs propres analyses. Pendant six mois, j’ai été immergé dans un long bain d’analyses féminines. J’en suis sorti en le racontant : c’est ainsi qu’est né le roman « La Femme aux liens », dans lequel j’essaie à mon tour de guider l’analyse d’une femme.
L’analyse est une tentative de connaissance totale. Une femme, on ne la connaît pas en vivant avec elle, en lui faisant l’amour ou en étant son confesseur. On la connaît quand on la découvre là où elle ne se connaît pas elle-même. Dans ses fantasmes, obsessions, troubles, rêves. Dans la société, ce dévoilement est perçu comme une mort. L’un des moments les plus angoissants de mon activité d’écrivain a été lorsqu’une femme de ma ville, après avoir lu le livre, m’a envoyé un cahier d’observations qui partait de ce postulat : « C’est mon histoire, je me sens dévoilée, il ne me reste plus qu’à me tuer. » Je lui ai répondu en publiant son cahier en annexe des éditions de poche du livre, analysant ses phrases une par une. J’espère que cette femme l’a lu.
Entre analyse et littérature il y a une fraternité qui devient rivalité. Je me suis souvent demandé pourquoi. Ma réponse est que parmi tous les mots, celui qui a la plus grande efficacité thérapeutique est celui qui est doté du plus grand quotient esthétique. Un problème, on le reformule cent fois en analyse, mais à un moment donné on s’arrête parce qu’on ne peut pas le formuler mieux que la dernière fois ; il en va de même lorsqu’on écrit un roman. On arrête de réécrire la même scène quand on l’a enfin exprimée, or l’expression est l’exact contraire du refoulement. L’analyse est une formation à l’expression, exactement comme la littérature. Ceux qui passent leur vie à écrire, c’est-à-dire à exprimer, ne peuvent pas coexister avec la répression. C’est pourquoi je considère comme mortel (littéralement) l’acte par lequel Pasolini a décidé de rompre sa relation avec Musatti. J’ose croire que s’il avait continué, il serait encore en vie. Et aujourd’hui, peut-être qu’il serait là.
(1) Titre français actuel, une traduction plus littérale serait « La maladie appelée homme ».
(2) « Culture » : c’est-à-dire ici « acquise », alors que « nature » signifierait « innée ».
© Ferdinando Camon, traduit de l’italien par © Sophie Képès
Dans « Désappartenir – Psychologie de la création littéraire », il y a un chapitre intitulé « Dévoilement » et un autre « Autocensure ». Et il se trouve que je cite les propos de l’Italien Ferdinando Camon, l’un des rares écrivains contemporains à avoir intégré la psychanalyse à son œuvre et combattu l’autocensure chez les écrivains. Je m’autorise d’ailleurs dans mon essai à mentionner quelques écrivains français qui cèdent à cette dernière. Il n’en demeure pas moins que le dévoilement par l’écriture amène à se sentir exposé et vulnérable face à la société et à l’entourage. Cette prise de risque coûte cher à l’auteur et j’ai payé mon dû quand le livre est sorti.
On peut se le procurer ici (descendre en bas de la page) => https://www.maurice-nadeau.net/parutions/307/desappartenir
Pour en revenir à Camon, c’est un écrivain d’une très grande puissance narrative et d’une originalité absolue. J’ai l’intention de découvrir le reste de son œuvre, n’ayant lu et relu jusqu’à présent que deux ou trois livres de lui. Et pour inaugurer cela, j’ai traduit ce texte d’une exceptionnelle acuité.
(N.B. : S’il vous plaît, ne partagez pas cette publication !)