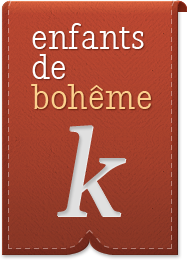
Par Sophie Képès le 11 Juil 2025
(Nouvelle extraite du recueil Sauvée par Shakespeare,
publié sous le pseudonyme Nila Kazar aux éditions Qupé, 2017).
Au milieu du bar le plus kitsch de la ville, une femme se tortillait comme une électrocutée sur les morceaux de la discothèque eighties constituée par le barman. La femme avait trop bu, et ses joues étaient aussi pourpres que sa tunique de lin largement échancrée. Elle invitait à danser tous les mâles disponibles, y compris les plus récalcitrants, ceux dont on devinait au premier coup d’œil qu’ils avaient été des croûtons rassis dès leur tendre enfance et avaient toujours fait tapisserie dans les surprise-parties de leur adolescence.
C’étaient les invités d’un congrès international qui se tenait au centre culturel voisin. Bien que sérieusement imbibés – les alcools locaux titraient à soixante degrés –, ils résistaient encore au laisser-aller de rigueur en fin de soirée. La femme soûle s’attaquait aussi à ses consœurs, qui acceptaient de meilleure grâce de virevolter avec elle entre les tables surchargées de verres et de bouteilles. Je les observais, assis sur une banquette dans le recoin obscur où j’avais mes habitudes. Qu’est-ce qui m’avait pris de me joindre à ce groupe, après le dîner officiel où chacun avait tâché de faire bonne impression à l’ambassadeur et à sa femme, des crétins pompeux ? Qu’est-ce que je foutais avec ces demeurés qui se gobergeaient sans pudeur dans cette ville-là entre toutes, ce jour-là entre tous ?
J’avais eu besoin de me changer les idées, je suppose. Gravement besoin.
Je me levai et, zigzaguant entre les danseurs, me rendis aux toilettes. Pendant que je me déboutonnais, je remarquai un écran placé en hauteur dans un angle des pissoirs, qui n’y était pas à ma dernière visite. Je me figeai : sur l’écran défilaient des images pornographiques d’une qualité médiocre. Deux types, un blanc et un noir, étaient en train d’enfiler sans imagination une blonde à gros nibards. Le son était coupé, ce qui rendait la scène encore plus déplacée. Je remballai mon oiseau : je n’avais plus envie.
– Qu’est-ce qui t’a pris, Jan ? demandai-je au patron en sortant. C’est quoi, cette vidéo pourrie dans les chiottes ?
– Shttt ! fit-il en posant un doigt malicieux sur ses lèvres. C’est pour les clients i’ consomment plus. Paremment iz’ ont plus soif quand i’ sont excités, tu vois, mon gars ?
Ses yeux innocents et son anglais approximatif m’incitèrent à laisser tomber la conversation. D’ailleurs il ne s’appelait pas Jan, mais Jasminko, alors à qui je parlais ? La femme en rouge continuait à se démener pour réchauffer l’ambiance languissante. Je la contournai et regagnai mon coin, me laissant choir lourdement sur les coussins. Je n’en pouvais plus, tout à coup. J’étais debout depuis six heures du matin et il était une heure passée, le lendemain.
Six heures du matin. J’attendais, mon sac à mes pieds, seul dans la ruelle déserte qui longeait des bâtiments officiels. Il pleuvotait et je frissonnais dans mes vêtements d’été.
Ils arrivèrent avec vingt minutes de retard. Je me hissai à l’intérieur du minicar à porte coulissante et nous partîmes aussitôt. Nous étions cinq : à l’avant, les deux chauffeurs ; sur la banquette, une femme dans la quarantaine et un homme dans la trentaine ; et moi, tassé contre la lunette arrière, tel un môme emmené en vacances par ses parents. Je ne connaissais personne, nous ne nous étions pas présentés à part un vague salut. Une amie commune nous avait réunis pour cette excursion particulière. Empêchée de venir, au dernier moment elle m’avait proposé de prendre sa place. J’avais sauté sur l’occasion.
Nous sortîmes rapidement de la ville et, presque sans transition, ce fut la campagne, verte et monotone. On se taisait dans la voiture, les occupants sommeillaient, excepté le chauffeur. Vers huit heures et demie, on s’arrêta à une station d’essence. Je sortis me dégourdir les jambes, m’étirai, me frottai les yeux. En plein mois de juillet, le temps était frais, humide et venteux. Parfait pour une journée de deuil.
Les deux autres passagers s’étaient mis à parler ; je me rendis compte qu’ils n’étaient pas d’ici, comme moi. Consonnes chuintantes… Des Polonais ? Le visage étroit de la femme, ses cheveux courts, poivre et sel, me disaient vaguement quelque chose. Quant à l’homme, avec ses lunettes de soleil à la mode et sa casquette américaine, il ne m’évoquait rien. Mais j’avais encore l’esprit engourdi…
Le copilote remplaça le pilote et on redémarra. Je décachetai la bouteille d’eau minérale que j’avais fauchée à l’aube dans un placard de la cuisine de mon hôte, l’attaché linguistique, et m’en jetai deux rasades dans le gosier.
Enfer et damnation ! C’était de l’eau-de-vie maison, un abominable tord-boyaux qu’on avait conditionné dans une bouteille de plastique d’un litre et demi. Je me mis à tousser, réprimant des haut-le-cœur d’autant plus violents que j’avais l’estomac vide. Tout le monde se tourna vers moi et, cramoisi, grimaçant, les yeux pleins de larmes, j’expliquai par gestes ce qui m’arrivait.
Les autres s’esclaffèrent. Au moins, la glace était rompue, et moi, tout à fait réveillé. Dès que les chauffeurs eurent saisi la situation, ils se tapèrent sur les cuisses et, bien sûr, réclamèrent leur part. « Pas question, vous conduisez ! », protestai-je. Surtout, j’espérais rapporter la bouteille à son propriétaire sans être obligé de lui révéler ma méprise. Mais rien à faire, je dus céder. Ils prélevèrent chacun une goulée généreuse, clapèrent de la langue, puis me rendirent la bouteille et, beaux joueurs, firent mine de l’oublier. Sauf qu’à partir de ce moment, ils me surnommèrent « Mister Loza ». ça ne me gênait pas, ici comme ailleurs j’avais pris le parti d’être ridicule. C’est une cuirasse comme une autre, de jouer les demeurés.
Au bout d’un moment, le trafic se densifia sur la route départementale jusqu’à former un énorme bouchon ; des autobus mastodontes immatriculés aux quatre coins de l’Europe, des berlines familiales mouchetées de boue, d’arrogants quatre-quatre mafieux luttaient roue contre roue pour progresser sur la chaussée trop étroite. Quand il fut las de klaxonner pour dégager le passage, notre conducteur posa un gyrophare sur le toit, déclencha la sirène et se mit à remonter la file de bagnoles sur la voie de gauche.
Mon amie m’avait signalé que je voyagerais dans un véhicule de police banalisé. Sur le moment je n’y avais pas prêté attention, mais à présent je trouvais ça pratique : nous filions à toute allure ! Ces deux chauffeurs si sympathiques – par chance, des buveurs modérés – devaient donc être des flics en civil. Je poursuivis mon raisonnement : cela signifiait que les occupants du véhicule étaient placés sous la protection des autorités. Et comme il n’y avait aucune raison pour que moi, je le sois, ce devait être les Polonais…
Cette fois, je dévisageai plus attentivement la femme qu’il me semblait connaître : mais oui, c’était Anna, la fameuse médecin-légiste ! Je l’avais vue dans plusieurs films consacrés au travail acharné qu’elle menait depuis dix ans pour identifier les restes des victimes et les restituer à leurs familles. à mes yeux elle était une héroïne, une sorte d’Antigone. Malgré les obstacles innombrables, le manque d’argent et de volonté politique, elle s’obstinait sans relâche. Je l’admirais beaucoup trop pour oser lui adresser la parole directement, alors que je rêvais de la rencontrer depuis longtemps et de faire son portrait pour le magazine. Mais puisqu’elle voulait rester incognito, que faire ?
Sous le coup de cette découverte, je ne m’étais pas aperçu que nous avions bifurqué sur une vicinale. Nous cahotions d’un nid-de-poule à l’autre. Soudain les chauffeurs échangèrent quelques répliques animées, la voiture fit demi-tour, s’engagea dans un chemin de terre. Était-ce un raccourci ? Étions-nous arrivés ? Nous progressions péniblement au milieu de la forêt. Enfin le minicar freina et se gara sur un parking improvisé où stationnaient déjà quelques véhicules. Tout le monde descendit et se faufila entre les feuillages dégouttants de pluie. L’un des flics m’invita à mettre mes pas dans les siens sans m’écarter du sentier fraîchement tracé – les alentours étaient restés minés depuis la guerre. Resté à la traîne, je perdis de vue Anna et son compagnon.
Soudain je débouchai dans une clairière. Je me figeai sur place. Nous n’étions plus seuls. Autour d’une fosse commune qui balafrait le sol sur une vingtaine de mètres, des personnalités et des journalistes s’agitaient sous les feux des projecteurs. On interviewait Anna pour la télévision. L’ancien Haut Représentant de la Communauté Internationale arriva, fit un discours de trois minutes, disparut. Le nouveau Haut Représentant arriva, fit un discours de trois minutes et demie, parla à Anna, lui serra la main et disparut. Il n’était plus question de discrétion.
Tout en râclant sur un tronc d’arbre mes chaussures gainées de boue gluante, je suivais des yeux ce ballet à distance, abasourdi. J’ignorais où nous nous trouvions : était-ce le but de notre voyage ? Cette clairière minuscule perdue dans les bois ? Je ne voyais rien de familier, je n’osais interroger quiconque… Les bras ballants, je me sentais idiot.
Au bout d’un moment, je me décidai à faire le tour de la fosse, examinant les squelettes à quelques mètres en contrebas, une trentaine environ. Ces ossements et les chiffons qui avaient été des vêtements n’évoquaient plus du tout les vivants à qui ils avaient appartenu. Je n’éprouvais rien. Alors que j’arrivais à l’autre extrémité, un petit bonhomme barbu et chevelu, affublé d’un poncho imperméable jaune vif, attira mon attention. Penché sur la fosse commune, il sanglotait. Parent d’un disparu ? Frappé par cette émotion extravertie qui contrastait avec l’impassibilité générale, je m’approchai de lui. C’était un compatriote. Je lui murmurai quelques paroles de réconfort. Porté par une nouvelle vague de détresse, il se jeta dans mes bras en s’écriant : « Le fascisme, ah, le fascisme…! »
Les verres de ses lunettes étaient trempés – pluie et larmes mêlées. Il était irrésistiblement clownesque dans son poncho canari, comme Roberto Benigni dans « La vie est belle ». C’était mesquin, mais ça me réconfortait de tomber sur un étranger encore plus ridicule que moi.
– Tu fais la marche commémorative ? demandai-je en lui tapotant le dos.
– Oui, balbutia-t-il. C’est très éprouvant. Surtout que le temps est épouvantable. Mais on ne va tout de même pas se plaindre, hein ? Par rapport à ceux qui ont fait cette même marche il y a dix ans sous la menace des fusils, pour finir dans des charniers creusés à l’avance… On est plus nombreux cette année, c’est ça qui nous soutient moralement. On y croit. On croit que cette marche est indispensable pour rappeler au monde ce qui s’est passé ici. Pour lutter contre l’oubli.
– Tu as raison. Moi, je n’ai pas eu le courage de la faire.
Je le repoussai doucement. Il s’essuya les yeux, se moucha.
– L’année prochaine, peut-être ? fit-il.
J’acquiesçai sans me compromettre. « Mister Loza ! Mister Loza ! » appela le chauffeur, indiquant d’un geste la direction du minicar.
– Faut que j’y aille. Heureux de t’avoir rencontré.
Il me serra longuement la main. Alors que je m’éloignais, une journaliste s’approcha de lui avec son bloc-notes :
– Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd’hui ?
Je souhaitai mentalement bon courage à la fille.
En un quart d’heure de route, nous étions rendus sur les lieux de la commémoration. Entre vingt et trente mille personnes s’entassaient autour de l’arène où elle se déroulait. Anna se fondit aussitôt dans la foule, un appareil-photo à la main, pour prendre des clichés des inhumations des quatre cents corps qu’elle avait identifiés depuis l’an dernier. Antigone redevenait anonyme. Moi, je quittai nos anges gardiens et grimpai à flanc de colline pour trouver un endroit d’où je pourrais embrasser du regard toute la cérémonie et m’imprégner de l’atmosphère. Le magazine m’avait commandé un reportage « humaniste »…
Sous un velum, des imams priaient, ne s’interrompant que pour laisser un proche égrener au micro les noms de ceux qu’on enterrait ce jour-là. Comme d’étroites barques trop légères, les cercueils drapés de vert glissaient de bras en bras jusqu’à leur emplacement définitif dans les longues tranchées sinueuses, tapissées de planches pour faciliter les descentes au tombeau. Des femmes à la tête couverte, agenouillées à côté des stèles individuelles, se lamentaient ou se recueillaient en silence. Un mémorial de pierre courait à un mètre du sol, sur lequel des milliers de noms étaient déjà gravés par ordre alphabétique. Beaucoup de place avait été ménagée en prévision des inhumations à venir.
Au-dessus de l’arène, autour de moi, la foule allait et venait ; les femmes plus nombreuses que les hommes, pour la plupart des vieillards ou des adolescents. Certains d’entre eux suivaient le rituel funèbre, levant les paumes vers le ciel, les passant sur leur visage, s’inclinant profondément sur l’herbe. D’autres déambulaient, se saluaient, bavardaient, pique-niquaient, passaient des coups de fil sur leur téléphone mobile. Les exilés de la diaspora retrouvaient leurs proches, échangeaient des nouvelles des absents. Les filles, qu’on repérait à leurs fichus clairs et fleuris, se promenaient enlacées par deux ou trois. Elles s’étaient pomponnées pour l’occasion, et les gars en profitaient pour leur lancer des œillades. On devinait des amorces de flirts et, qui sait ? de mariages.
Vu de loin, tout ça ressemble un peu à une kermesse, pensais-je avec étonnement. Même si le deuil et le chagrin prédominent, ça n’empêche pas la vie de circuler. De redresser la tête.
Et je m’en réjouissais. Oh, comme je m’en réjouissais.
Juste en face de moi, un gros nuage flasque coiffait une colline qui adoptait la forme d’un terril ou d’un tumulus. Pendant que je restais là, immobile, le nuage blanc-gris ne cessa de descendre et de remonter, de se dilater et de se contracter. Adossé à un muret, écoutant et observant, levant les yeux de temps à autre sur le nuage qui absorbait et régurgitait mollement la colline, je me découvrais guéri de la rage incrédule, de la peine déchirante qui m’avaient submergé au moment du massacre.
Non, tout ceci n’était plus mon affaire.
Sur le chemin du retour, nous fîmes halte dans le petit bourg où avaient été pratiquées la sélection des hommes avant leur extermination et l’évacuation des femmes et des enfants. Je faussai compagnie aux autres pour parcourir lentement à pied la rue principale où s’était déroulé l’avant-dernier acte de la tragédie. Du haut de leurs terrasses, quelques habitants ethniquement purs et affreusement pauvres me suivaient d’un regard amorphe. Une seule femme, très maigre, le visage hâve, les cheveux gris, crut nécessaire de brandir trois doigts en signe de victoire. Des chiots trottaient sur mes talons. Je les caressai longuement, les laissai mordiller tout leur soûl le bas de mon pantalon. Ils avaient faim, eux aussi. J’aurais bien voulu leur donner quelque chose à manger.
Nous repartîmes. Dans le minicar, on était plus loquace qu’à l’aller. Le Polonais, qui s’était avéré être un collègue journaliste, me raconta en anglais qu’il avait publié une biographie du médecin-légiste. Plongé dans un état quasi hypnotique – j’étais tellement harassé que j’en avais la nausée –, je l’écoutais sans mot dire. Anna aussi écoutait, hochait la tête en souriant, protestait quand son compagnon la portait aux nues : « Allons, Wojtek, tu exagères ! Ne fais pas de moi un personnage de fiction, s’il te plaît ! » Je me sentais magnétisé par elle. Cette femme avait quelque chose… une aura ? – je ne savais pas comment l’appeler. Je la couvais du regard. J’avais un tas de questions à lui poser, elles se bousculaient sur mes lèvres. Une occasion unique s’offrait à moi de l’interviewer, et je restais paralysé. Impuissant et furieux contre moi-même.
Pourquoi prenez-vous des photos des inhumations ? Pour qui ? Que représente pour vous la tâche surhumaine à laquelle vous avez tout sacrifié ? Pourquoi vous ? Pourquoi dans ce pays qui n’est pas le vôtre ? Et d’ailleurs, d’où vient tout cela – le nuage sur la colline, les chiots affamés, les milliers de morts, les familles en deuil ?…
J’étais sûr qu’Antigone détenait toutes les réponses à mes questions. Mais je fus incapable d’en formuler une seule jusqu’à notre retour en ville.
En début de soirée, à peine rentré chez mon hôte, je me dirigeai vers la cuisine. Je rangeai la bouteille de loza là où je l’avais trouvée une éternité plus tôt, me fis couler un verre d’eau fraîche et allai m’écrouler dans un fauteuil de la salle de séjour. Je restai quelques minutes pelotonné dans la pénombre rayée des persiennes, savourant le liquide à petites gorgées comme si c’était la meilleure chose au monde.
Soudain j’entendis les pas de l’attaché linguistique qui descendait l’escalier. Incapable de m’extirper du fauteuil, je ne bougeai pas. Quand il entra dans la pièce, je lui dis bonsoir. Il sursauta d’une façon que je trouvai exagérée :
– Mais qu’est-ce que tu fous là ? Depuis quand t’es rentré ?
– Je viens juste d’arriver.
Il alluma le plafonnier. Je me tassai sous l’éclairage blafard. Pendant qu’il passait à la cuisine et fouillait dans le frigo, je me ressaisis. Il revint avec un soda :
– Alors, c’était comment ?
– Qu’est-ce que tu veux savoir exactement ?
– Ben, le trajet, la cérémonie, tout, quoi…
Je commençai à lui raconter ma journée tant bien que mal. Il m’interrompit :
– Mais ça ressemble à quoi, une fosse commune ? J’en ai jamais vu, décris-moi !
Je m’efforçai de satisfaire sa curiosité. Il ne cessait de réclamer des détails d’un ton presque agressif. Obscène. Je finis par prétexter ma fatigue pour me lever :
– Je vais prendre une douche et me changer. N’oublie pas que ce soir, je t’accompagne au dîner chez l’ambassadeur. Au fait, tu lui as demandé, pour la réception du Quatorze-Juillet ?
– Ah ! bien sûr… Mais je n’ai rien pu faire pour toi, les invitations sont strictement nominatives. Désolé, mon vieux !
Un mensonge, de toute évidence. Il n’avait pas envie de m’y voir, pour des raisons obscures. Ça m’embêtait, je comptais y rencontrer des gens utiles à mon reportage.
– Quand tu es arrivé, je travaillais à mon histoire pour enfants, lança-t-il alors que j’étais déjà dans l’escalier. J’aimerais bien que tu la lises et que tu me donnes ton avis avant que Catherine et les gosses reviennent de la Côte.
– Pas de problème, assurai-je.
Compte pas sur moi, pauvre type, crachotai-je entre mes dents tandis que l’eau brûlante de la douche ruisselait sur mes épaules contracturées. « Ça ressemble à quoi, une fosse commune ?… » « Les invitations sont strictement nominatives… » Quel connard ! J’étais certain qu’il regardait des vidéos pornos sur internet quand j’étais rentré. D’où le sursaut coupable.
Le lendemain matin, je sortis prendre un café au centre-ville pour chasser les vapeurs alcoolisées de la veille. Le temps était radieux. J’achetai un journal local avant de m’installer à la terrasse d’un patio dont les façades grêlées par la mitraille n’avaient pas encore été restaurées.
Je feuilletai le quotidien où étaient relatées les cérémonies commémoratives à travers le pays. Je ne parlais pas la langue, mais j’arrivais à deviner l’essentiel. Sur une photo je reconnus, avec un pincement de regret, Anna et son hagiographe. Continuant à parcourir le journal, je tombai sur une autre connaissance : le doyen de la fac de lettres, un homme remarquable que j’avais commencé à interviewer quelques jours plus tôt, venait de succomber à un infarctus. Pas possible, lui qui s’inquiétait tout le temps pour la santé de sa femme ! Je lâchai le journal, choqué : comment se faisait-il que les gens d’ici continuaient à mourir de mort naturelle ? Ça me semblait extrêmement injuste, après tout ce qu’ils avaient subi.
Le serveur apporta mon café. Il le tenait à deux mains, comme un objet lourd et précieux. Ses mains tremblaient pendant qu’il le posait sur la table. Je levai les yeux sur lui : c’était un gamin de seize ans, le visage criblé d’acné, un rondouillard pataud tout juste sorti de sa campagne, mal dégrossi.
– Merci, fis-je avec un sourire encourageant.
– Je débute, c’est mon premier jour de travail.
– Dans ce cas, bonne chance, mec. Tiens, apporte-moi aussi une bière, je la boirai à ta santé.
Deux citadines à peu près du même âge que lui s’installèrent à une table voisine. Elles venaient de faire des courses et se montraient leurs trouvailles à la mode en poussant de petits cris extatiques. Elles commandèrent des sandwiches. Quand le garçon les apporta, ses mains tremblaient encore plus fort. Les deux pétasses toisaient le petit plouc avec un mépris manifeste. L’une d’elles ouvrit son sandwich et l’inspecta avec une moue de dégoût. Elle rappela le serveur et lui ordonna de le refaire selon ses désirs. Tandis qu’il s’éloignait vers le comptoir, l’air indiciblement humilié et contrit, les jolies garces échangèrent des commentaires ironiques assez haut pour qu’il en profite.
C’est alors que le chagrin me tomba dessus à l’improviste. Les larmes me montaient aux yeux, j’avais la gorge nouée, les joues brûlantes. J’étouffais de tristesse en repensant à la cérémonie de la veille, et au vieux prof de fac qui ne viendrait pas à notre prochain rendez-vous. J’étais sur le point de me lever, laissant ma bière en plan, lorsque quelqu’un s’approcha de moi d’un pas décidé.
La femme en rouge du bar d’hier.
Aujourd’hui elle était en bleu.
– Je crois qu’on se connaît, non ? dit-elle.
J’inclinai le menton.
– Vous participez aussi au congrès ?
– Non, on s’est vus chez l’ambassadeur. Et ensuite, au bar. Vous dansiez.
– Ah oui.
Elle eut l’air embarrassé. Pas longtemps.
– J’avais un peu trop bu, je crains.
– Possible.
– Je peux m’asseoir ?
Je lui indiquai le siège en face du mien. Elle prit place. à la lumière du jour, elle paraissait plus âgée que je ne l’avais cru. À moins que les excès de la nuit précédente… Je lui lançai d’un ton abrupt :
– Au fait, vous savez quel jour on était, hier ?
– Le 11 juillet, non ?
– Oui. Le 11 juillet. Vous savez ce que cette date signifie pour les gens de ce pays ?
Elle me fixa d’un air déconcerté.
– Évidemment, je suis au courant. On n’y vient pas par hasard.
– Je pensais que peut-être, vous ne… Enfin, vous et vos collègues, vous aviez tellement l’air de…
– Touristes ? proposa-t-elle avec une grimace.
J’éclatai de rire malgré moi :
– Exactement. Et je ne peux pas le supporter. Pardonnez-moi, je ne peux pas.
Elle parut réfléchir.
– Je vous comprends, dit-elle. On se comporte toujours comme de vrais idiots dans ce genre de congrès, vous savez ? Coupés du train-train quotidien, confinés en vase clos… D’un autre côté, je pense, moi, que la seule chose appropriée à faire ici, c’est précisément de s’éclater. De se soûler. De baiser. Bref, de déconner à pleins tubes.
– Vous ne diriez pas ça si vous étiez venue ici à l’époque.
– Vous êtes venu, vous ?
– Oui, juste après le cessez-le-feu. Si vous aviez vu comme les choses et les gens étaient détruits…
Elle m’observait toujours, une lueur de gaîté au coin des yeux.
– Et c’est à cause de ça que vous pensez qu’on n’a pas le droit de s’amuser ici ?
– Je ne dis pas ça. Mais hier, c’était la commémoration… Le dixième anniversaire du massacre…
Elle resta pensive un instant, hochant la tête.
– Moi aussi je suis venue ici autrefois, dit-elle enfin. Pendant le siège, j’ai passé quelques semaines dans cette ville.
– Vous ? Vous étiez là ?
– Oui, pour tourner un film documentaire. Et j’ai beaucoup fait la fête à l’époque. C’est pourquoi je continue. Ça vous étonne ?… Vous savez, après que vous avez quitté le bar hier soir, j’ai dansé avec le cousin du barman. Il vivait là aussi quand j’y étais – au beau milieu du champ de tir. On ne s’était pas rencontrés alors. On ne se connaît pas du tout. Mais hier, pendant qu’on dansait ensemble, on se sentait très proches, même si on se touchait à peine. On s’est aimés très fort pendant trois minutes… Comme à l’époque, où l’amour était omniprésent. Moi, je crois qu’il est très important de rire et de jouir ici, justement dans cette ville. Vous n’êtes pas obligé de partager cet avis. Mais le cousin du barman m’approuverait, je crois.
Le garçon lui apporta son café, et je notai que ses mains ne tremblaient presque plus. C’était le métier qui rentrait. À la table voisine, les garces avaient disparu.
– Quelle belle journée, n’est-ce pas ? reprit la femme. Je crois que je vais en profiter pour aller visiter mes morts au cimetière militaire. Hier, il pleuvait trop. Vous m’accompagnez ?… Arrêtez de me fixer comme ça, j’ai vraiment une tête de zombie ? Non ? Alors… Voyez-vous, la dernière fois que je suis montée là-haut, au-dessus du bazar, il faisait très chaud, j’étais épuisée et toute en sueur. Pour me reposer un peu, je me suis assise sur la tombe d’un jeune homme que j’ai connu pendant la guerre et qui est enterré là, après vingt années d’existence dont trois atroces passées dans les tranchées. J’avais le vague sentiment que je n’aurais pas dû, mais je ne tenais plus sur mes jambes. Et là, un gardien sorti de nulle part s’est rué sur moi et a crié : « Debout ! il est interdit de s’asseoir sur les tombes des martyrs ! » Je me suis levée et j’ai bégayé : « Mais c’est un cousin à moi, je viens exprès de Paris pour visiter sa tombe, il est de ma famille… » Je disais n’importe quoi, bien sûr je mentais, j’étais sous le choc. Le gardien a changé immédiatement de ton : « Allez-y, je vous en prie ! » a-t-il dit en m’invitant d’un geste à reprendre ma place sur le tertre. Il s’est excusé une bonne dizaine de fois. Alors j’ai remarqué sa casquette de travers et sa vareuse ouverte, sa beauté, sa jeunesse – il n’était pas plus âgé que le serveur d’ici, je crois –, et tandis qu’il s’éloignait à reculons en continuant à s’excuser devant moi, la soi-disant cousine d’un de leurs soi-disants martyrs, enterré à trente mètres du père-fondateur de l’État, je songeais : comme il est désirable, ce garçon, j’aimerais tant caresser cette poitrine lisse et blanche que j’entrevois par l’échancrure de son col… Oui, voilà à quoi je pensais ! Je me suis rassise sur l’herbe, et j’ai évoqué l’image du jeune homme qui gisait sous terre, le comparant au gardien qui aurait pu être son neveu si les générations s’étaient succédé sans heurt, sans cette horrible brèche de la guerre. Et je me suis mise à pleurer et à rire à la fois, me moquant de mes fantasmes de dame mûre… Pardon, je vous ennuie ? Vous êtes pressé, peut-être ?
Je secouai la tête. Je n’avais désormais rien de plus urgent à faire que d’écouter le récit de cette inconnue en rouge, en bleu.
– Encore une chose, alors… Pendant la guerre, voyez-vous, par la magie d’un phénomène mystérieux, les gens d’ici étaient tous devenus transparents. On lisait en eux comme à livre ouvert, on savait instantanément à qui l’on avait affaire. Ce lieu tragique était une sorte de faille dans l’espace-temps, un trou noir qui aspirait les exaltés dans mon genre, les révoltés, les asociaux… Non, ne protestez pas ! Je me connais – je nous connais. Être asocial n’empêche pas de devenir un résistant, bien au contraire… Ce que j’essaye de vous dire, c’est qu’aujourd’hui cet endroit est redevenu normal. Enfin, pas politiquement ni socialement normal, hélas, mais humainement normal, c’est-à-dire : médiocre, décevant, contradictoire. La faille dans l’espace-temps s’est refermée, et la confusion universelle a repris le dessus. L’entropie générale. On rit, on pleure, on prie, on danse, on se soûle, on désire, on trompe, on enfante, on vieillit, on vend, on vole, on tombe malade, on guérit, on part, on revient…
Et pendant qu’elle poursuivait son énumération, je poursuivais la mienne en silence : on s’étrangle avec de l’eau-de-vie, on marche sous la pluie avec un poncho canari, on meurt brutalement d’un infarctus, les demoiselles se payent la tête des péquenauds, un gros nuage joufflu aspire la colline et la recrache…
Et moi, je suis ici. Je suis en vie ici, où tout est normal à présent, normal comme partout ailleurs. Comme à la maison, chez moi, où je retournerai dans quelques jours.
– Au fait, vous vous appelez comment ? demandai-je en activant l’enregistrement sur mon portable.
J’allais enfin pouvoir l’écrire, ce foutu reportage.
Tous droits réservés, © éditions Qupé – Sophie Képès