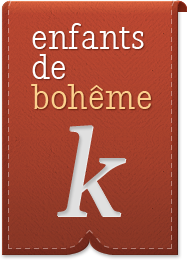
Blog
L’écriture comme affirmation et effacement de soi
Par Sophie Képès le 27 Oct 2025
Préface de Carmen MUSAT à la version roumaine de « Désappartenir. Psychologie de la création littéraire »
Écrivaine, traductrice de littérature hongroise, scénariste, éditrice et critique littéraire – avec un intérêt particulier pour les littératures d’Europe centrale et des Balkans –, Sophie Képès occupe une place à part dans le paysage culturel français contemporain. Avec un père juif hongrois, issu d’une famille d’émigrés en France, qui a refusé de parler sa langue maternelle à ses enfants et a caché pendant des années ses origines juives, et d’une mère française, hostile et dominatrice, Sophie Képès est une auteure située à la confluence de plusieurs cultures, ainsi que de divers domaines d’expression artistique. Bien que née en France, elle a été élevée dans « la culture typique d’une famille juive d’Europe centrale », avec des racines, du côté paternel, en Hongrie et en Transylvanie, dans le creuset multiethnique et multiconfessionnel de cette Europe centrale à laquelle elle se réfère constamment, comme à la matrice fabuleuse d’une histoire personnelle à découvrir ou à inventer.
Sélectionné par le prix Femina de l’essai en 2023, lauréat du prix de la Fondation Charles Oulmont en 2024, Désappartenir. Psychologie de la création littéraire (2023) est un essai à la Montaigne, dans lequel l’auteure se propose d’explorer les mécanismes secrets de l’écriture, les sources cachées qui déclenchent le processus de création, abordées du point de vue de la lectrice, de l’écrivaine et, enfin et surtout, de la professeure qui, depuis 2003, donne un cours de création littéraire à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Convaincue que « l’écriture surgit des débris hétéroclites que la marée du temps abandonne sur le rivage de la mémoire en se retirant », Képès réfléchit dans tous ses livres sur les fonctions de la littérature en tant que moyen d’agir dans le monde. Et, motivée par l’histoire de sa propre famille – qu’elle explore avec une persévérance infatigable, poussée par le désir « d’explorer à l’aveuglette, de ramener au jour des fragments énigmatiques en vue de les déchiffrer et de les ordonner » –, elle refuse de laisser disparaître le passé personnel et collectif. Réfractaire aux modèles et aux théories, pratiquant un éclectisme culturel bien tempéré, Sophie Képès recourt à l’essai, personnel par définition, par besoin d’aborder librement une série de thèmes qui la préoccupent et qui se retrouvent, sous une autre forme, dans ses romans et nouvelles publiés précédemment. D’ailleurs, tout l’échafaudage de cette démonstration substantielle a pour point de départ sa propre expérience, à laquelle elle revient sans cesse après de longs détours par les œuvres d’autres auteurs, comme dans un jeu de miroirs dont l’effet immédiat est une mise en abîme des concepts qui figurent comme titres des séquences composant le sommaire du présent ouvrage. On ne trouve rien de la sécheresse savante des études prétendument académiques, si nombreuses aujourd’hui, dans les pages de cet ouvrage fascinant par la richesse de ses références bibliographiques et par les connexions surprenantes que l’auteure établit entre des livres d’une grande diversité et des écrivains des quatre coins du monde. En effet, l’un des impératifs qui déterminent cette démarche est celui de redécouvrir le contact direct, sans l’intermédiaire de théories à la mode – aussi éphémères que la mode elle-même –, avec les œuvres littéraires et les personnes qui les ont créées. Sophie Képès sait par expérience que derrière chaque auteur se cache un être vulnérable, au passé souvent traumatisant, qui transparaît inconsciemment dans ses écrits. Et comme l’intérêt personnel pour les racines familiales se conjugue avec le besoin aigu de comprendre le rôle de l’héritage culturel dans le devenir d’un écrivain, je serais tentée de dire que, dans la mesure où son enjeu n’est pas seulement la psychologie, mais aussi la généalogie de la création, la recherche présentée ici est d’essence foucaldienne, s’inscrivant « dans ce champ où se manifestent, se croisent, s’enchevêtrent et se spécifient les questions de l’être humain, de la conscience, de l’origine, et du sujet » (1).
Du mystère du texte, qui révèle ce que l’écrivain ne veut (ou ne peut) pas savoir, à la manière dont les univers fictionnels créés par les écrivains déterminent leur vie ultérieure, de la définition mimétique de la littérature comme représentation du monde à l’exploration de l’impact remodelant que la littérature exerce sur le monde, les coupes pratiquées par Sophie Képès dans les livres lus et relus avec une passion non dissimulée transcendent les courants, les écoles, les générations ou les spécificités nationales. Partant des textes littéraires pour aboutir à des conclusions théoriques, Képès met au jour des arguments solides qui lui permettent d’affirmer que la littérature est « un jeu permanent de saute-frontière de la réalité à la fiction, du flou, du mixte, de la subversion – bref, de l’impur ». L’impureté, cette caractéristique essentielle de l’être humain et de la fiction, constitue donc l’un des thèmes centraux de la recherche entreprise par l’écrivaine française, et elle est également la caractéristique déterminante du discours pratiqué dans Désappartenir. En choisissant la deuxième personne du singulier comme marqueur de son discours, Sophie Képès fait un effort d’objectivation et assume, d’une part, la distance par rapport aux souvenirs douloureux de son enfance, ainsi que la peur résiduelle de l’impact que ces révélations pourraient avoir, tout en signalant d’autre part son implication directe, le recours à sa propre subjectivité, qui détermine et conditionne le choix des thèmes, des concepts, des auteurs et des œuvres littéraires discutés. Du choix du thème à la construction minutieuse de l’argumentation, l’analyse proposée par Sophie Képès est incompatible avec la rigidité d’une « méthode scientifique », mais pas avec la rigueur conceptuelle. S’abandonnant à l’intuition critique et à l’inconscient du langage, l’auteure ne renonce à aucun moment à la rigueur du chercheur authentique, à la recherche de la « vérité de l’artifice » – le mentir-vrai fréquemment évoqué tout au long de ces pages.
Plus vraie que la réalité, la fiction est le résultat d’un processus alchimique de transmutation réalisé par l’écriture. Pour décrire le travail de l’écrivain, Képès compare les procédés auxquels il recourt à ceux propres à l’inconscient dans le rêve – le déplacement et la condensation, car écrire n’est rien d’autre qu’une manière de traduire la réalité extérieure, concrète et extrêmement diverse, en réalité intérieure, et, au-delà, la réalité intérieure en langage. Ce n’est pas un hasard si deux des séquences incluses dans ce volume traitent de lirécrire et d’écrilire, la lecture et l’écriture étant, dans la vision de Sophie Képès, les deux versants d’une même montagne impossibles à dissocier lorsqu’il s’agit d’écrivains. Et comme l’écriture et la lecture supposent toutes deux l’action de traduire un ordre dans un autre, un langage dans un autre, la mission de l’écrivain est, entre autres, de rendre le monde intelligible pour l’Autre, le lecteur. C’est aussi la raison du périple intense d’un livre à l’autre, d’un univers fictif à l’autre et d’un écrivain à l’autre entrepris ici par Képès.
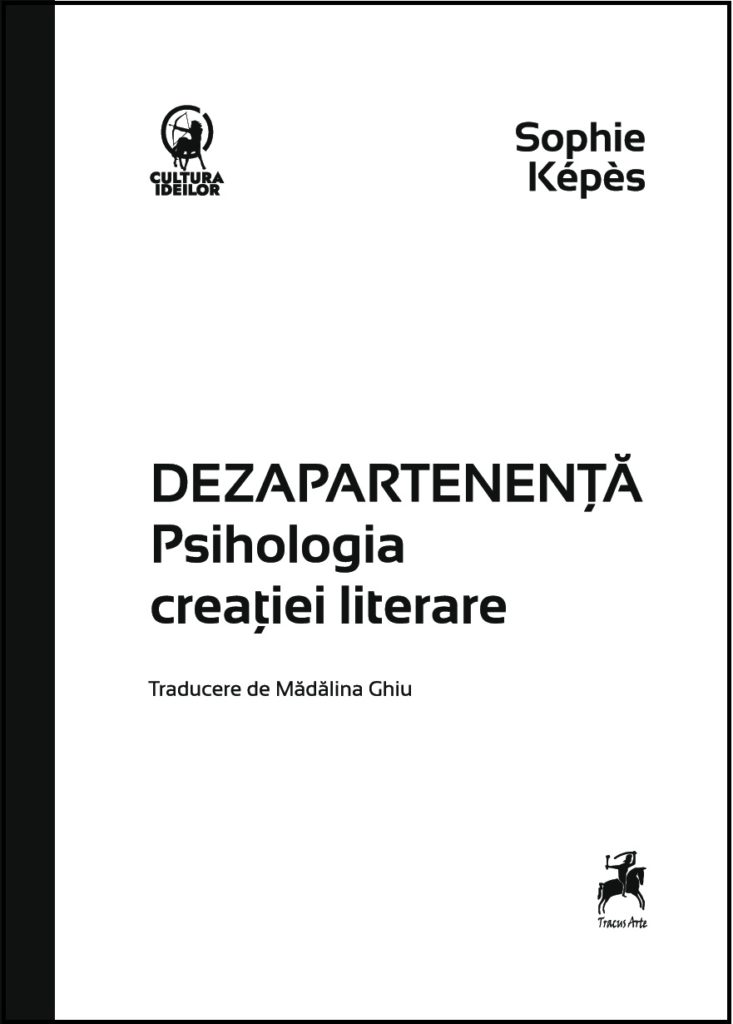
Et nombreux sont ceux qui témoignent, à travers leurs œuvres, qu’il existe une continuité évidente entre la biographie et l’œuvre et que, pour devenir écrivain, il faut « l’action sournoise de la biographie » dont parlait Danilo Kis, l’un des auteurs-totems de Képès. Parmi les écrivains lus et très souvent cités, on trouve plus de 45 noms des deux côtés de l’Atlantique, dont l’activité couvre les deux derniers siècles de littérature, des auteurs d’une grande diversité culturelle, stylistique, thématique et narrative. Outre ceux déjà mentionnés, on trouve ici, dans un ordre tout à fait aléatoire, Kafka, Proust, Tchekhov, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Ernesto Sábato, Rilke, Dezsö Kosztolányi, Joyce Carol Oates, Jorge Semprun, Nancy Huston, Elfriede Jelinek, Romain Gary, Tolstoï, Dostoïevski, Philip Roth, Cesare Pavese, Primo Levi, Stendhal, Beckett, Sartre, Joseph Conrad, Céline, Georges Perec, Anaïs Nin, Henry Miller, Faulkner, Doris Lessing, Marguerite Duras, Camus, Edna O’Brien, Toni Morrison, Pierre Michon, Eugène Ionesco, Harold Pinter, Musil, George Sand, François Villon, James Joyce, Julio Cortázar, Siri Hustved, Ivo Andrić, Stieg Dagerman, Attila József, Victor Hugo et bien d’autres encore. Qu’ont en commun tous ces écrivains, qu’est-ce qui pousse Sophie Képès à les réunir dans les pages de ce livre ? D’une part, la conviction que l’écriture signifie à la fois l’affirmation et l’effacement de soi, mais aussi que la biographie – en particulier les expériences traumatisantes de l’enfance – déclenche le mécanisme de la création, comprise comme un transfert fondamental de la vie vers l’œuvre. Les commentaires à valeur heuristique que fait Sophie Képès sur les œuvres littéraires sélectionnées mettent en évidence le double pouvoir de l’écriture de cacher et de révéler des indices précieux sur la psychologie de la création et la biographie de l’auteur. L’analyse entreprise ici n’est pas de nature psychanalytique, même s’il existe des références aux théories de Freud et de Lacan sur la relation avec le père – en particulier, sur les conséquences engendrées par la « carence paternelle » sur le processus créatif –, car l’objectif principal poursuivi par Képès est d’identifier les principaux moyens par lesquels la biographie peut être « vaincue » par l’écriture, mais aussi dans quelle mesure, en écrivant, nous pouvons devenir autres, pour paraphraser Foucault.
L’idée de révéler le pouvoir salvateur de l’écriture est doublée, dans l’essai présenté ici, par celle de parler de l’écriture comme d’un processus continu de désaffiliation ou de désappartenance, défini comme une condition sine qua non de la liberté et de l’authenticité de l’artiste. Nécessaire pour se retrouver soi-même, la désaffiliation suppose l’effort conscient de « se libérer de toute loyauté autre que celle qui est due à l’œuvre ». C’est là un autre point où la pensée de Sophie Képès rejoint la perspective de Foucault qui, dans son étude consacrée à Raymond Roussel (2), évoquant le « secret visible » caché dans le texte, estime nécessaire de souligner la double tendance de l’écriture à être à la fois un mode de révélation/connaissance de soi et un mode de détachement de soi. Au fond, ce que dit Sophie Képès, c’est que la révélation qui se produit à travers l’écriture est un processus inconscient, qui échappe à la volonté de l’auteur, mais qui ne peut être indifférent au lecteur, toujours à la recherche du « mystère » du texte. Que ce mystère soit étroitement lié à la biographie de l’auteur semble aller de soi, même si, pour le déchiffrer, il faut partir de l’idée que la littérature suppose ce mentir-vrai théorisé par Louis Aragon, et qu’en fin de compte, la biographie de l’auteur fait partie intégrante de l’œuvre. Paradoxaux et le plus souvent accablants, les secrets personnels de l’auteur peuvent, selon Matei Călinescu, être « confessés indirectement, dissimulés dans l’acte même de leur déclaration bruyante, exagérée ou trahie au moment même où ils sont cachés » (3). Ils continuent à hanter les textes des auteurs, « comme les fantômes hantent les vieilles maisons » (cf. Călinescu), générant des problèmes textuels provocateurs pour celui qui les lit. Or, ce sont précisément ces problèmes textuels qui sont signalés et examinés par Sophie Képès, qui lit tous les textes « en profondeur », entre les lignes, telle une détective désireuse de révéler les secrets du texte et, implicitement, de les mettre en corrélation avec les événements de la biographie de l’auteur.
Pour Sophie Képès, les cas de « trouble originaire », tels ceux de Romain Gary, Pierre Michon, Jean-Paul Sartre ou James Joyce, donnent naissance à des représentations tout à fait particulières des rapports entre le moi auctorial et l’œuvre, caractérisées par l’ambiguïté qui résulte du jeu avec les identités. Situé dans un coin de la scène, et non au centre, assumant son rôle de témoin du monde qu’il crée, l’auteur (en tant que sujet biographique) est à la fois présent et absent de son propre texte, la mission du lecteur étant de le récupérer et de le mettre en lumière. C’est peut-être pour cette raison que le style n’est plus conçu comme une question de technique, mais principalement de vision. L’auteur devient ainsi l’enfant de son livre – un « livre intérieur », selon les termes de Proust – tout autant qu’il en est l’auteur (l’étymologie fournit à Sophie Képès des suggestions interprétatives d’une grande subtilité). Nous avons affaire ici à une manière originale d’aborder les relations entre le texte littéraire et la biographie, conditionnées par les règles du langage artistique que le besoin de désappartenance altère irrémédiablement, comme c’est le cas par exemple dans l’œuvre de Samuel Beckett, où il reflète la dégradation irrémédiable des liens sociaux. Étroitement liés entre eux, le miracle de la communication et du langage littéraire et le besoin de découvrir le sens des choses, au-delà de l’apparente succession chaotique des événements, constituent pour l’auteure de cet ouvrage les principaux objectifs de son approche synthétique. Car il est évident que, pour les auteurs réunis ici comme pour Képès elle-même, le langage de l’œuvre n’est pas seulement un véhicule abstrait, mais acquiert la consistance de l’histoire personnelle, en tant que dépositaire des traces impossibles à ignorer de la biographie.
Le choix fait par Sophie Képès de la technique qu’elle appelle elle-même « litt’frag » – qui consiste à découper et juxtaposer des fragments littéraires qui se mêlent et s’organisent selon le principe du kaléidoscope – confère une souplesse à un discours qui naît à la croisée de la confession, du commentaire critique appliqué, de la narration (auto)fictionnelle et de l’essai. Pour une auteure qui, à la suite de Nabokov, considère l’imagination comme une forme de mémoire et de suspension du temps, mais aussi comme un ingrédient nécessaire, destiné à contrecarrer la tentation de l’autocensure – qui dans ce cas n’est pas déterminée par la politique, mais dont les mobiles sont à rechercher dans l’intimité et les « allégeances imaginaires » invoquées par Virginia Woolf –, la seule formule stylistique adaptée au thème énoncé dès le titre est cette écriture libérée des contraintes du discours académique rigide, parfaitement articulée à la lisière de l’autobiographie littéraire. Désappartenir n’est pas seulement un livre qui révèle les ressorts profonds de sa propre œuvre fictionnelle, mais aussi, dans une égale mesure, une incursion fascinée et fascinante dans la littérature de certains des écrivains les plus connus au monde. C’est aussi une façon de compenser l’absence de la famille biologique et de l’affection parentale en s’inventant une famille littéraire qui regroupe tous les auteurs qu’aime Sophie Képès, redécouvrant ainsi un sentiment d’appartenance qui naît en même temps que celui de la désaffiliation.
Mai 2025
Carmen Mușat est professeure à la Faculté des Lettres de l’Université de Bucarest, critique littéraire, rédactrice en chef de la revue Observator cultural, directrice de la collection « Culture des idées » chez Tracus Arte éditions.
- 1. Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Gallimard, 1969.
- 2. Raymond Roussel, Gallimard, 1963. Foucault médite sur le dernier texte de Roussel, Comment j’ai écrit certains de mes livres (1935), témoignage testamentaire écrit à la fin de sa vie, pour arriver à la conclusion que ce texte transforme en énigme permanente tout ce qu’il semble révéler.
- 3. Matei Călinescu, Lire, relire, Humanitas, Bucarest, 2017.