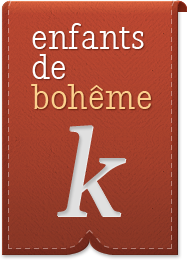
Par Sophie Képès le 27 Déc 2025
Cette nouvelle a été publiée dans le recueil Sauvée par Shakespeare (Qupé, 2017) signé du pseudonyme Nila Kazar.
« C’est ce qu’on appelle un écrivain, a dit Schwartz. Il sait
et en même temps il ne sait rien. » F. S. Fitzgerald, Le dernier nabab
– Et tu te rappelles quand on est allés à la campagne, chez le père de Marta ?
Je secouai la tête :
– Pas du tout.
Kostia me considéra de son œil bleu, dubitatif.
– Voyons, Sylvie, impossible que tu aies oublié ça ! Il nous a montré des pièges à ours, de vieux engins avec d’énormes mâchoires rouillées.
Rien ne me revenait. Pourtant, l’image aurait dû m’impressionner. Même maintenant, je frissonnais légèrement.
– Non, je regrette.
Kostia réfléchit en silence. Il cherchait une autre anecdote pour réveiller ma mémoire défaillante.
– Et ton frère…
– Quoi, mon frère ?
– Il m’avait donné un parapluie. Il donnait des parapluies à tout le monde…
J’admettais volontiers ce fait-là, plus crédible que le précédent. Mon frère était d’un naturel protecteur, et Kostia semblait alors tellement démuni, aussi erratique qu’un météore attiré par les champs gravitationnels de différents corps célestes. Je l’admettais, mais je ne me le rappelais pas. Comment se faisait-il que j’aie tant oublié de ma vie d’étudiante ? Ma mémoire n’était pas si mauvaise en général. Mais de cette époque ne surnageaient que peu de choses. Et pas les mêmes que celles qu’il avait retenues, lui.
À présent c’était moi qui dévisageais l’homme assis en face de moi sur la banquette de velours. Est-ce qu’il n’était pas en train de se payer ma tête ? Je doutais de ses souvenirs. Je le savais capable d’en inventer, de modifier à satiété les versions d’un épisode, de se vautrer avec délice dans la contradiction. Après tout, il était écrivain. Le « mentir-vrai » d’Aragon, c’était sa manière d’être. Lectures, invention, langage, expérience vécue : quelle différence ? Il s’ébattait librement dans un univers composite, chimiquement impur.
Moi aussi, puisque j’étais écrivain, tout comme lui. Parfois je commençais à raconter à quelqu’un une histoire – par exemple, que dans tel aéroport j’étais tombée sur une vieille connaissance menottée, revêtue d’un gilet pare-balles et encadrée par deux policiers –, avant de me rendre compte que je ne l’avais pas vécue, mais écrite.
Gibiers de romance, fictionneurs forcenés, nous étions des prosateurs-nés sans ambiguïté, à part chez moi une phase d’incontinence lyrique entre dix-huit et vingt-deux ans, rapidement jugulée. La seule chose qui comptait pour nous : 1. écrire, 2. réécrire. Repousser nos propres limites à chaque tentative. Qu’importait si nous restions méconnus, en attendant que la postérité change d’avis… Qu’importait si nos livres participaient à la confection de l’humus dans lequel s’enracinait le succès de camarades plus chanceux, consacrés par l’époque… Qui, à vingt ans, a rêvé de devenir un écrivain mineur ? Personne. Mais on serre les dents et on avance sans regarder sur les côtés, comme un cheval de trait qui creuse son sillon. Il n’y a rien d’autre à faire.
Et puis, c’est connu, seuls les perdants sont de grands écrivains. L’écriture est le suicide des lâches.
Parfois, je me consolais en pensant que Kostia était un auteur plus mineur que moi. Je le soupçonnais de penser l’inverse, ce qui ne nuisait nullement à la cordialité de nos rapports… Il continuait à rêvasser, accoudé à la table où traînaient nos verres vides. La fin de l’après-midi s’étirait, le café était assez calme, les damnés de la terre n’ayant pas encore été relâchés par leurs maîtres. Kostia et moi disposions du plus grand privilège qui soit en ce monde malade : la maîtrise de notre emploi du temps (assortie de difficultés chroniques de trésorerie). Justement, j’avais envie d’un débat de fond, long et plein d’imprévus dans sa grandiose inutilité. J’attaquai :
– À ton avis, Kostia, pourquoi devient-on poète plutôt que romancier ? On dirait que ça va de soi. Mais d’où vient notre inclination pour un genre donné ?
– Est-ce que tu te souviens de Maougocha ?
Kostia était un as du coq-à-l’âne. La perspective réjouissante du débat théorique s’éloignait.
– Oui, bien entendu. C’était ta copine quand tu es arrivé en France.
Je revoyais vaguement les traits frustes de la jeune fille, sa chevelure épaisse, implantée bas sur le front, qui accentuait son air primitif de Lilith agraire. Je trouvais le couple mal assorti, mais je gardais ça pour moi. Il était très amoureux d’elle. C’était Maougocha qui lui avait révélé les plaisirs du sexe libéré. J’imaginais aisément quel bouleversement ç’avait été, pour un homme qui débarquait d’un univers totalitaire, de s’initier à notre décadence occidentale par la voie la plus directe… Voilà comment un intellectuel racé en vient à faire l’amour dans une baignoire pour la première fois de sa vie à l’âge de trente-cinq ans ! Un « vieux », pour notre petit clan d’étudiants dans la vingtaine. Il nous impressionnait d’autant plus. C’était notre héros, Kostia le dissident, toujours à contre-courant dans ces années-là – les années « plutôt rouge que mort »…
Nous l’admirions. Il y avait de quoi ! Philosophe de formation, il avait d’abord fait parler de lui chez nous par une publication anonyme, un samizdat parvenu jusqu’ici sous forme de microfilm, comme dans les romans d’espionnage, où il dézinguait le régime avec une ironie mordante. Il risquait des années de goulag ou l’internement dans un hôpital psychiatrique, ce qui l’avait conduit à émigrer en France. C’est là que je l’avais rencontré, quelques mois après son arrivée.
Son regard sarcastique me clouait au pilori sans ménagement quand une puérilité m’échappait, ce qui m’arrivait souvent. Il m’avait lancé, après avoir lu mon premier roman : « C’est un livre qui ne sert à rien. » Parce que les livres étaient censés servir à quelque chose ? Sa remarque m’avait refroidie à son égard, mais je n’étais pas montée sur mes grands chevaux (« mes hauts chevals », aurait-il dit à l’époque). Je n’aurais pas su quoi répondre, de toute façon. Plus tard seulement, pendant sa longue absence, je commencerais à comprendre ce qu’il avait voulu dire. Il avait eu raison, mais trop tôt pour moi. On ne peut pas reconnaître une vérité tant que l’heure n’a pas sonné.
Je tentai une diversion :
– Kostia, tu n’as pas changé depuis Maougocha. Ton poil a blanchi, c’est tout. Tu te rappelles quand tu es passé à la télévision, dans cette fameuse émission où tous les auteurs rêvaient d’être invités ? Tu as conservé ton chapeau sur le plateau, et tu ne l’as ôté que pour fixer la caméra et nous saluer par nos noms, nous, tes copains. On était fiers de te connaître ! Personne n’avait jamais osé faire ça !
Il eut un sourire lointain qui s’effaça presque aussitôt.
– Figure-toi que j’ai revu Maougocha la semaine dernière.
– Hein ? Comment ça ?
– J’étais en Vendée, au bord de la mer. Mon portable était à plat. Je suis entré à la bibliothèque municipale pour recharger ma batterie. J’ai fait quelques pas en attendant, j’ai jeté un coup d’œil dans la salle de lecture – et elle était là, au rayon philo.
– Elle était… Maougocha ?
– Oui, enfin, une jeune femme de l’âge de Maougocha quand nous étions ensemble, qui lui ressemblait de façon extraordinaire. Je suis allé vers elle, je ne pouvais pas m’en empêcher. Je lui ai adressé la parole au sujet des livres qu’elle empruntait. Elle aussi était d’origine polonaise. En vacances dans le camping voisin.
– Et puis ?
– Et puis, rien. On a échangé quelques phrases, je ne trouvais plus rien à lui dire, elle non plus. Je suis parti. J’étais dans un état épouvantable, ravi, terrifié. Exactement comme autrefois… Elle aurait pu être sa fille, la fille de Maougocha – notre fille. Pourquoi pas ? Sylvie, tu te rends compte ?
Eh oui, Kostia, je me rends compte : te voilà tout excité, plein de nostalgie. On dirait que tu ne te souviens pas de ce dont, moi, je me souviens… À savoir que Maougocha t’avait quitté pour un boucher.
Un boucher ? À présent ça me paraissait invraisemblable. Était-ce un souvenir-écran, comme la mémoire se plaît à en fabriquer ? Ou un mot déformé par l’accent de Kostia (sa diction traînante, ses o prononcés comme des eu, ses ni comme des gni…) : pas un boucher, mais un débauché ? Ou encore, une métaphore furibonde : ce salaud était le boucher de leur amour ? En tout cas, je me rappelais très précisément mon sentiment lorsque j’avais appris la nouvelle : ça lui va bien, à Maougocha. Passer de la philosophie à la charcuterie, c’est tout à fait elle.
Les joues de Kostia étaient enluminées par sa tendre évocation. Ou par les deux kagniaks qu’il venait d’absorber ? Ça aussi, c’était fluctuant : un jour il se déclarait abstinent depuis des décennies, le lendemain il atterrissait en cellule de dégrisement. L’habitude littéraire du « mentir-vrai » ? Ou celle de brouiller les pistes pour échapper à la police politique ? Je l’avais entendu répondre à un compatriote exilé qui l’interrogeait : « Vous êtes bien Kostia B. ? – Ah, ça, qui sait ? Il faudrait le prouver. » Et quand, passé à l’Ouest depuis peu, on lui attribuait la paternité du fameux samizdat, il démentait vigoureusement. Est-ce qu’à force de jouer au plus fin, il savait encore qui il était ?
Il se leva et se dirigea vers les toilettes. Pendant qu’il descendait les marches, je sortis mon téléphone et composai le numéro de mon frère :
– Tu te rappelles mon copain Kostia ? L’écrivain russe ?
– Kostia… Ce type mal élevé que tu avais emmené une fois chez moi quand on était étudiants ?
– Ah, tu le trouvais mal élevé ? Mais dis-moi, est-ce que tu lui avais donné un parapluie ?
– Un parapluie ? Je ne m’en souviens pas. Ce qui ne veut pas dire que je ne l’ai pas fait, conclut mon frère avec objectivité.
Et voilà, pensai-je en raccrochant, c’est tout le temps comme ça avec Kostia. Confusion, trouble, incertitude… Même Marta, sa traductrice et amie intime, était souvent déconcertée par son attitude. Un jour, elle m’avait raconté qu’il avait essayé de l’attirer dans une secte. Je m’étonnai :
– Mais puisqu’il croit en Dieu, à quoi bon une secte ?
– Peut-être qu’il ignore que c’en est une. Mais j’ai eu un soupçon et j’ai vérifié. J’ai décliné son invitation sous un prétexte quelconque.
– Tu lui en as parlé ?
– Non. Pour quoi faire ?
– Pour lui éviter de tomber dans les filets de cette secte.
– Je suis sûre qu’il n’y tombera pas, Sylvie. Il est trop intelligent.
– Mais ça n’a rien à voir avec l’intelligence ! Tu sais quoi, Marta ? Je crois que Kostia est resté naïf, comme à son arrivée chez nous.
– Naïf, lui ? Il est tellement ironique !
– N’empêche. Il y a des choses qu’on ne maîtrise jamais tout à fait, à moins d’être né sur place. Il y a des pièges qu’on ne reconnaît pas.
Pas aussi monstrueux que des pièges à ours – quoique… Le problème avec Kostia, c’était qu’à force de brouiller les repères, à force de nous égarer sur de fausses pistes, il était devenu davantage un personnage de fiction qu’un auteur de fiction. Mais ça, je ne le dis pas à Marta.
C’était aussi un merveilleux fournisseur d’anecdotes pittoresques. Quand j’étais en panne d’inspiration, je piochais sans vergogne dans son stock personnel – par exemple, ses aventures d’enquêteur au service du gouvernement dans le Kazakhstan des années 1960. Les questions portaient, entre autres, sur l’hymne soviétique : « Faut-il changer la musique ? les paroles ? la référence à Staline ? » Pour lui, ç’avait été une occasion unique de passer du côté du pouvoir pendant quelques semaines : voiture avec chauffeur, interprète personnel, logement somptueux, bureaucratie aux ordres. Il avait inventé la plupart des réponses à l’enquête, surtout celles des femmes, peu enclines à s’exprimer librement dans leur yourte, tandis que leur mari galopait dans la toundra. Du coup, ses résultats différaient sensiblement de ceux des autres Républiques… J’adorais cette histoire qu’il m’avait relatée plusieurs fois, avec de multiples variantes. Il jubilait encore à l’idée d’avoir embobiné le régime.
– Sylvie, regarde-moi, dit Kostia, de retour du sous-sol.
Clic-clac, il me prit en photo.
– Qu’est-ce que tu fais ?
– C’est pour illustrer mon article sur toi dans mon blog. Et il me faudrait aussi la couverture de ton dernier bouquin, numérisée.
Pourquoi t’intéresses-tu à moi, Kostia ? Je ne suis pas intéressante. C’est toi qui es intéressant… Je n’avais pas envie de me livrer à ce diable d’homme. Pour gagner du temps, je lui demandai de me montrer la photo sur son portable. On m’y voyait assise au premier plan, la tête auréolée par la lumière dorée de l’après-midi finissante. Derrière moi, dans le miroir, se reflétait sa silhouette debout, les mains jointes, tel un commanditaire de retable anonyme.
– Ah, voilà Sergueï, notre écrivain maudit ! s’écria soudain Kostia.
La diversion tombait à pic. Pendant que son compatriote prenait place à notre table, retirant son manteau et son chapeau de cuir, et qu’ils entamaient une discussion animée dans leur langue maternelle, je me laissai à nouveau dériver vers le passé.
Lorsque mon clan et moi, nous avions mis en scène une performance conçue par Kostia, au cours de laquelle il crevait et traversait un voile de plastique utérin, l’interprétation s’était imposée d’elle-même : il s’arrachait symboliquement à l’emprise conjointe de sa mère et de sa patrie (de sa mère-patrie) pour renaître à l’Ouest en homme neuf. Enfin, c’était l’idée qu’on avait mise dans le programme, car il n’avait rien expliqué. Mais nous savions qu’il avait été élevé par sa mère célibataire dont il portait le nom, ignorant tout de ses origines paternelles. Il proclamait que ça n’avait aucune importance, puisque les écrivains sont les enfants de leurs livres, pas de leurs parents. Ça aussi, il me faudrait des années pour le comprendre vraiment…
À l’époque il allait très mal, Maougocha venant de rompre avec lui. La nuit qui suivit sa performance, il nous appela au secours, mon petit copain Thierry et moi. Accourus à son chevet, nous le trouvâmes seul chez les gens qui l’hébergeaient, gisant par terre, marmonnant des paroles incohérentes, pressant frénétiquement un crucifix contre sa poitrine. Pas une simple croix, mais le corps du Christ se tordant de douleur avec un réalisme atroce… Et sous lui, notre Kostia se tordant de la même façon ! J’étais effarée. Nous réussîmes à le calmer, à le coucher, et repartîmes très inquiets. L’excès d’alcool était sans doute pour beaucoup dans la scène. Peut-être aussi le penchant slave pour l’exagération théâtrale. Mais le crucifix ? Que venait-il faire là ?
– En Russie, commenta Marta appelée à la rescousse le lendemain, alcool et religion jouent à peu près le même rôle qu’antidépresseurs et télévision ici.
Soit ! Deux jours plus tard, elle le vit dévaler l’escalier, sac au dos, le crâne rasé, l’air traqué, refusant de répondre à ses questions. Et il disparut pour la première fois de nos vies. Il m’envoya deux cartes postales de Normandie, où il s’était retiré dans un monastère. Il faisait des allusions au bouleversement qu’il était en train de vivre. Je n’y comprenais rien, là encore.
Au bout de quelques mois, de retour de Normandie, Kostia et sa femme Nadejda (oui, il était marié et sa femme avait émigré avec lui – il ne nous l’avait jamais dit…) nous invitèrent, Thierry et moi, à leur rendre visite dans leur petite maison particulière à 15 km de Paris. Tout semblait rentré dans l’ordre. Sauf qu’à un moment, Nadejda me confia en aparté qu’il parcourait les champs environnants pendant des journées entières et ramenait à la maison les animaux malades qu’il trouvait. La salle de bains était envahie. Et il leur parlait, tel un François d’Assise de banlieue : « frères lapins, sœurs brebis »… Bref, notre Kostia « battait la campagne », au sens propre et figuré.
Quelque temps après, il disparut pour de bon. Pendant une quinzaine d’années, aucun d’entre nous n’eut de nouvelles de lui.
Un jour, je reconnus sa voix à la radio. Il parlait d’un livre qu’il venait de publier, où il racontait ses vagabondages. Il était devenu une sorte de pélerin mendiant, de saint homme errant. Il était allé à pied jusqu’à Jérusalem. Puis, rentré à Paris, il avait vécu dans la rue. J’aurais pu le croiser à proximité de la station de métro où il demeurait souvent. J’avais dû le croiser, en fait. Sans le voir.
J’achetai aussitôt le livre. Le plus frappant, c’était que sans le moindre doute, pendant toutes ces pérégrinations Kostia était resté un écrivain à part entière. Même plongé dans un dénuement total, il n’avait jamais renoncé. Incroyable ! Sacré Kostia, jamais il ne cesserait de m’étonner… Pourtant je ne cherchai pas à rentrer en contact avec lui. Comment m’accueillerait-il ? Que lui dirais-je ? Nous n’étions plus les mêmes personnes.
Un an plus tard, à une réunion d’écrivains, le hasard nous remit en présence. C’est lui qui vint vers moi :
– Bonjour, Sylvie. Vous me reconnaissez ?
– Bien sûr, Kostia. On peut se tutoyer.
Ensuite, il tenta de renouer notre amitié de jadis. Mais sans savoir pourquoi, je le tenais à distance. Il ne m’inspirait plus tout à fait confiance. Et puis, il me posait des questions sur Thierry. Je ne voulais pas gâcher ses bons souvenirs de jeunesse, démentir sa nostalgie. Il me donna à lire un manuscrit autobiographique. C’est là que je découvris sa version des quelques mois où nous nous étions fréquentés : visions mystiques, hallucinations, conversion au christianisme… L’intensité torrentielle de la révélation, l’éblouissement du séisme intérieur – ce moment qui justifie toute une vie, c’était cela qu’il regrettait le plus. Et aussi, à ma stupéfaction, son histoire d’amour malheureuse avec Maougocha. Comment, avec le recul, n’avait-il pas pris conscience qu’elle était la femme qui, entre toutes, lui convenait le moins ?
Après tant d’années à le fréquenter, il était resté une énigme à mes yeux. Qui était-il au fond ? La vérité sur Kostia, voilà ce qui m’obsédait désormais, voilà ce que je traquais chaque fois que je le voyais. Car elle ne se cachait pas entre les pages de ce nouveau livre, j’en étais convaincue. Non, elle était ailleurs, et j’étais résolue à la déterrer, de gré ou de force. J’en avais assez des légendes, des à-peu-près, des images retouchées, des malentendus, du flou artistique.
C’était décidé, j’allais le coincer. Je me sentais prête.
Sergueï se leva, remit son manteau, souleva son chapeau dans ma direction et disparut. Il n’avait guère appris plus de dix mots de français en trente ans d’exil. D’ailleurs, en quoi méritait-il le surnom d’« écrivain maudit » ? J’allais interroger Kostia, mais il me devança :
– Alors, Sylvie, on le fait, cet entretien ? J’ai préparé quelques questions sur ton roman.
– D’accord, dis-je à contrecœur.
Il sortit un bloc-notes et un stylo.
– Bon, première question : est-ce un roman à clés ?
– Oui, c’est évident. Tu as reconnu quelques figures du milieu littéraire, je suppose.
– Quel était ton but en mettant le lecteur dans la confidence ?
– Je ne pensais pas au lecteur en l’écrivant. Je ne pense jamais au lecteur. Je fais ce que fait tout auteur de fiction : j’utilise l’univers que je connais. Certains parlent de la petite bourgeoisie provinciale ou de la paysannerie moribonde ; moi, je parle des grandeurs et misères du microcosme qui m’environne. Avec une bonne dose d’humour, j’espère.
Tout en m’efforçant de répondre intelligemment, je regardais le stylo de Kostia courir sur la page quadrillée. Il écrivait en cyrillique et parlait en français. J’étais épatée.
– Mais ta narratrice, c’est un peu toi, non ?
– Je m’y reconnais davantage que dans les autres personnages. Mais je suis moins séduisante qu’elle, quoique plus maligne, si tu veux mon avis.
– En quoi serait-elle moins maligne que toi ? Elle fait une carrière éblouissante.
– Qu’est-ce que tu insinues ? Je plaisante, Kostia ! Elle n’est pas très maligne dans le choix de ses amants. Non, encore un mauvais exemple. Je ne vaux pas mieux qu’elle en la matière.
Soudain, Kostia me transperça de son fameux regard d’entomologiste.
– Ce qui lui arrive à la fin, tu l’as inventé ?
– À quoi fais-tu allusion ? demandai-je, le sachant parfaitement. Des frissons glacés parcouraient mon échine.
– Quand elle quitte son copain et qu’il essaye de l’étrangler. C’est tellement réaliste… Les sentiments, les émotions sont si intenses, si authentiques… On dirait que tu l’as vécue, cette scène terrible. Et puis tu passes très vite à autre chose, comme si ça t’était insupportable…
Il s’interrompit. Je restais muette, les yeux baissés. Jamais je n’avais haï quelqu’un aussi fort. Si seulement j’avais pu le réduire en cendres par la seule force de mon désir !
– Excuse-moi, fit Kostia, tu n’es pas du tout obligée de répondre. Question suivante…
– De toute façon, murmurai-je, j’en ai plus qu’assez d’éviter le sujet… Oui, ça m’est arrivé, ça nous est arrivé. Quand j’ai voulu le quitter, Thierry a essayé de m’étrangler.
J’essayais vainement de contrôler le tremblement de ma voix.
– Tu te souviens, je travaillais dans un cabinet médical pour financer mes études. Quand je suis rentrée un soir, il s’est jeté sur moi. Il avait bu une bouteille de whisky dans la journée. Il avait fermé les volets et verrouillé la porte d’entrée derrière moi. Alors je me suis défendue, le dos au mur. De temps en temps j’essayais de lui parler. Mais surtout j’essayais de retenir ses mains qui s’accrochaient à mon cou. Tu te rappelles comme il était grand et fort ? Ça a duré des heures. Et puis, à un moment, j’ai senti qu’il vacillait. Il m’a lâchée, il était très pâle. Je savais que c’était fini. Il était tard. J’étais vidée. Je suis allée dans la cuisine et j’ai pris un couteau. Je me suis écroulée sur le canapé du salon, j’ai glissé le couteau sous un coussin, j’ai posé la tête dessus. Et je me suis endormie comme une masse. Avec Thierry à côté, dans la chambre. Au milieu de la nuit il m’a réveillée, il était assis près de moi, il pleurait et me demandait pardon, il avait juste voulu me faire peur, il ne m’aurait jamais tuée. Il me suppliait de rester avec lui. Moi, j’ai recouvré toute ma lucidité en une fraction de seconde. Je l’écoutais sans rien dire, je me disais : essaye seulement de me toucher, essaye… Je pensais au couteau sous le coussin et à rien d’autre, rien… Mais il m’a laissée tranquille. J’ai quitté l’appartement le lendemain matin. J’étais à la rue, comme toi, Kostia, qui avais disparu… Et j’avais mes premiers cheveux blancs. Littéralement, à vingt-cinq ans.
Quand je m’en sentis capable, je levai les yeux. Kostia fixait sa main inerte, recroquevillée sur le bloc-notes.
– Tu vois, dis-je, je n’ai jamais oublié cette histoire, mais je ne ressens aucune émotion quand j’y repense. C’est sans doute ce qui explique que j’aie refoulé tant de détails de cette époque, les pièges à ours, le parapluie de mon frère… Ma mémoire est cautérisée à cet endroit, autour de ce nœud-là.
– Excuse-moi, Sylvie, murmura Kostia. Je ne voulais pas…
J’éclatai de rire.
– Et comment, que tu voulais ! Je te connais par cœur, mon salaud !
Il parut désorienté – une expression très rare chez lui. Une victoire en soi.
– La vérité a une odeur spéciale, même planquée dans une fiction, tu ne trouves pas ? Mais ne t’inquiète pas pour moi, Kostia. J’ai refilé à ma narratrice toutes les émotions que j’étais censée éprouver, ça règle le problème. Par contre, j’aurais besoin de boire quelque chose de plus fort que ce jus de pomme.
– Tu veux un kagniak ?
Je m’esclaffai de plus belle. J’adorais la façon dont il prononçait ce mot-là.
– Excellente idée. Garçon, deux cognacs !
J’étirai mes jambes sous la table et bâillai. Pour la première fois depuis le retour de Kostia, je me sentais totalement détendue en sa présence.
– Quelle ordure, ce Thierry… Jamais je n’aurais cru qu’il…
– Non, Kostia, n’en parlons plus, s’il te plaît. Plus jamais.
– D’accord.
– Maintenant, c’est ton tour.
– Mon tour ?
Je le fixai en souriant. Et voilà le travail : au lieu de lui arracher les clés de sa vie, je lui avais livré les miennes ! « Roman à clés », tu parles ! Oui, Kostia, tu as gagné cette partie, une fois de plus. Tu es très fort aux échecs. Jouer à cache-cache avec une dictature pendant vingt ans, il faut croire que ça confère quelques atouts maîtres. Mais je vais prendre ma revanche. Je la découvrirai, ta vérité, tu vas voir… Mais d’abord, bois, Kostia. Bois.
Traversant la salle avec la légèreté d’un premier de ballet, le garçon s’approcha de nous, faisant valser sur son plateau rond deux verres ballons qui contenaient un fabuleux liquide aux reflets de topaze.
– Nazdarovie, dis-je en levant mon verre.
– Nazdarovie !